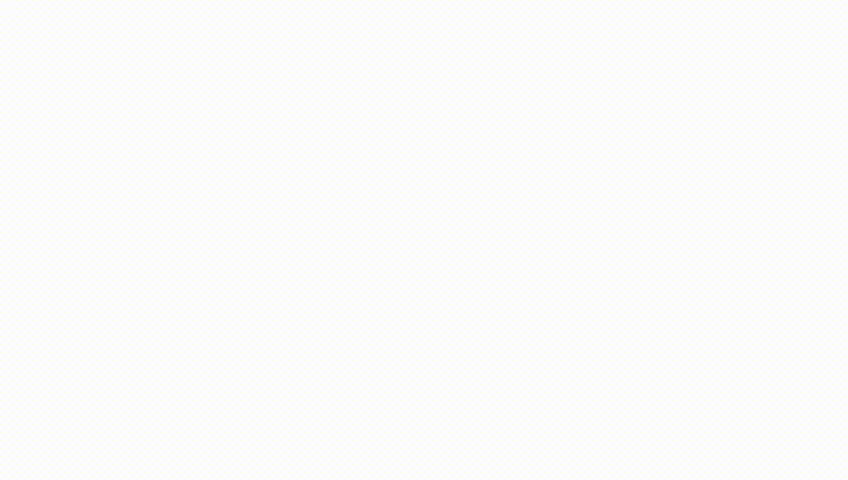La cour d’appel de Bruxelles a acquitté ce mercredi 26 mai, les journalistes Anouk Van Gestel et Myriam Berghe, qui avaient hébergé chez elles des migrants dans le cadre d’un reportage sur le sujet. Elles étaient poursuivies, aux côtés de quatre autres personnes, pour trafic d’êtres humains. Cette affaire nous rappelle que chaque jour, des milliers d’individus tentent d’atteindre l’Europe. Selon l’ONU, en moyenne 54 migrants, femmes et enfants confondus, périssent quotidiennement lors de traversées en mer, soit 20.000 personnes par an. Portés par l’espoir d’une vie meilleure, ceux qui arrivent à bon port se retrouvent parqués dans des camps de fortune, dans des conditions sanitaires déplorables ou sont enfermés dans des centres dans l’attente d’une décision. Sentence couperet: « vous ne remplissez pas les conditions ou, pire, vous avez menti » est une fois sur deux la conclusion d’un périple. Dommage collatérale d’une situation de désespoir, d’aucuns se font escroquer par des vendeurs d’histoires factices, ayant trouvé un business juteux dans le commerce de l’exil, quand ils ne se font pas exploiter par des trafiquants en tous genres.
« Oui, on a le droit d’héberger ! », a déclaré Myriam Berghe lors d’un rassemblement organisé à l’issue du verdict par le collectif citoyen « Solidarity is not a crime ». Le parquet reprochait à la journaliste d’avoir prêté de l’argent et son téléphone portable à un migrant qu’elle avait accueilli, soutenant que cela lui avait permis d’aider d’autres migrants à rejoindre la Grande-Bretagne. « C’est une énorme victoire et on a réussi à faire passer le message que, oui, nous avons hébergé des passeurs, mais qui sont eux-mêmes victimes de trafic d’êtres humains », a-t-elle préciser. Héberger dans un esprit solidaire est toutefois un pis-aller. La démarche humaniste ne fait pas office de régularisation pour les sans-papiers. En Europe, les politiques d’accueil de plus en plus restrictives mises en place depuis l’afflux massif de réfugiés et de migrants en 2015 ont eu pour effet pervers de développer des trafics florissant sur les routes migratoires vers l’Europe, mais aussi dans les pays d’accueil.
Un segment de marché prospère
La traite des êtres humains est sans doute le crime qui demande le moins d’investissement et qui comporte le moins de risques pénalement. N’importe qui peut s’y livrer, ce qui rend le phénomène particulièrement inquiétant. Selon l’Atlas mondial des flux illicites, dressé par Interpol, le centre d’analyses norvégien RHIPTO et la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, le trafic illégal et la traite des migrants constituent le quatrième secteur criminel au monde par son poids économique, avec une valeur marchande estimée à 157 milliards de dollars en mars 2021. Alors que le nombre de nouveaux arrivants est en chute libre un peu partout, les cas d’asservissement sont en revanche en pleine expansion.
L’exploitation la plus massive est l’exploitation des migrants par un travail à bas prix et dans des conditions de logement indignes. L’exploitation sexuelle des femmes est également en plein essor. Les premières concernées sont les Nigérianes. Entre 40.000 et 60.000 d’entre elles en sont victimes d’un trafic à grande échelle comparable à celui des jeunes femmes d’Europe de l’Est au début des années 2000. En 2015-2016, au plus fort de la crise des migrants, elles arrivaient par bateaux entiers en Italie, avant d’être directement prises en charge par des réseaux mafieux nigérians, tel le Black Axe, qui opèrent dans toute l’Europe. La mendicité forcée est une autre forme d’exploitation, mais son mode opératoire assez flou ne permet pas d’y associer des chiffres.
Angle mort : les mineurs non accompagnés
En réponse à l’austérité des politiques migratoires, on observe également une augmentation des mineurs non accompagnés en Europe, les familles s’imaginant que ces derniers auront de meilleures chances d’obtenir une régularisation par rapport aux adultes. Ces enfants représentent aujourd’hui 20% du flux des migrants depuis 2015 et sont issus majoritairement d’Afrique de l’Ouest, d’Afghanistan et d’Afrique du Nord. Les jeunes filles sont exploitées sexuellement et les garçons sont utilisés pour commettre des délits. Les adolescents marocains et algériens sont incités à effectuer des vols à la personne et des cambriolages. Les réseaux criminels albanais de trafic de stupéfiants, qui tiennent majoritairement le trafic de cocaïne et d’héroïne, utilisent quant à eux leurs jeunes compatriotes comme mules ou vendeurs-livreurs.
Des rêves et des papiers
Face à un parcours à l’évidence « du combattant », le statut précaire pousse également les demandeurs d’asile à échafauder des stratégies de survie pour ne pas être expulsés. Les « vendeurs de vie » n’hésitent pas à exploiter le filon. Contre monnaies sonnantes et trébuchantes, ils leur réinventent un passé. Ainsi, le Bengalais marchand de légumes sans le sou parce qu’on lui a confisqué ses terres devient un homosexuel persécuté dans son pays d’origine. Le profil passe mieux. Être en danger de mort est une condition d’accès pour obtenir le statut de réfugié politique. Ces faux récits de vie cabossée sont vendus à prix d’or à ceux qui n’ont déjà plus rien. Ce business très rentable de fraude à l’asile, qui vient se greffer au trafic d’êtres humains, générerait aujourd'hui plus de 6 milliards d'euros par an dans le monde. Perversité du système, nombreux sont les réfugiés qui remplissent sans le savoir tous les critères pour obtenir l’asile, mais achètent un faux récit en pensant à tort booster leurs chances.
Une fin de non-recevoir synonyme de fin
Lorsque le parcours est échec, l’issue peut être fatale. Le 6 janvier 2017, Denko Sissoko, un jeune Malien arrivé en France en octobre 2016, se suicide en se jetant par la fenêtre du 8ème étage de son foyer à Châlons-en-Champagne (Marne). La raison de ce geste ? Le jeune homme avait peur que la police ne vienne l'expulser. Après avoir fui le Mali, Denko Sissoko était passé par la Libye et l’Italie, où il était resté un an et demi, avant d’avoir assez d’argent pour rejoindre la France. Il s’était présenté spontanément au commissariat de Reims en novembre 2016 pour entamer une procédure de régularisation. Le 29 avril 2021, c’est en Belgique que l’actualité est rattrapée ce même type de faits. Mohamed (23 ans), un ancien réfugié du centre Fedasil de Mouscron, se donnait la mort après qu’on lui a refusé une énième fois l’asile. Après un long périple qui l’avait d’abord amené en Grèce, le jeune homme d’origine irakienne, était arrivé dans notre pays il y a 3 ans.
L’exil est par essence traumatique
Ces drames mettent en lumière une réalité négligée à l’analyse factuelle des chiffres migratoires : ce sont bien des êtres humains qui composent les statistiques. Derrière le huis-clos administratif de l’immigration, le rapport de force est pourtant déséquilibré lorsque ce joue l’espoir d’une vie meilleure. C’est oublier que l’exil demeure par essence traumatique. Les États montrent aussi peu de motivation à lutter contre la traite des êtres humains alors qu’une directive européenne de 2011 prévoit le principe de non-poursuite des victimes de traite lorsque celles-ci sont impliquées dans des délits. Cette réticence à agir s’explique par le simple fait que la plupart des pays craignent d’ouvrir une nouvelle voie à la régularisation des migrants en protégeant les victimes de traite. Seuls le Royaume-Uni et l’Italie ont actuellement créé des plateformes dédiées que n’importe quel citoyen peut appeler s’il soupçonne un cas de traite humaine dans son entourage. Au Royaume-Uni, ce système à lui seul a conduit à la reconnaissance officielle de 10.000 victimes en 2019 (chiffres 2020 non encore communiqués).
Le CGRA vient de lancer http://asyluminbelgium.be/, une plateforme permettant d’informer les demandeurs d’une protection internationale au sujet de la procédure en Belgique et ce, dans 9 langues (français, néerlandais, anglais, espagnol, arabe, pachtou, farsi, tigrinya et somali). Ce nouveau site Internet fournit des informations adaptées aux besoins du demandeur concernant le déroulement de la procédure de demande.
« SOS Migrants », en partenariat avec l’Asbl « Interpôle », propose tous les jours en semaine, de 10h à 17h, une permanence juridique, sociale et de santé, au 12 rue Locquenghien à 1000 Bruxelles - mail : sosmigrants@hotmail.com - site : www.sosmigrants.be