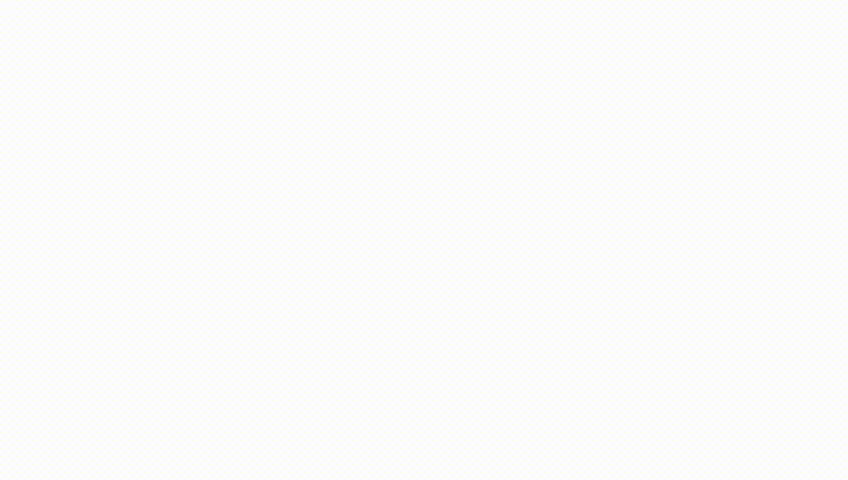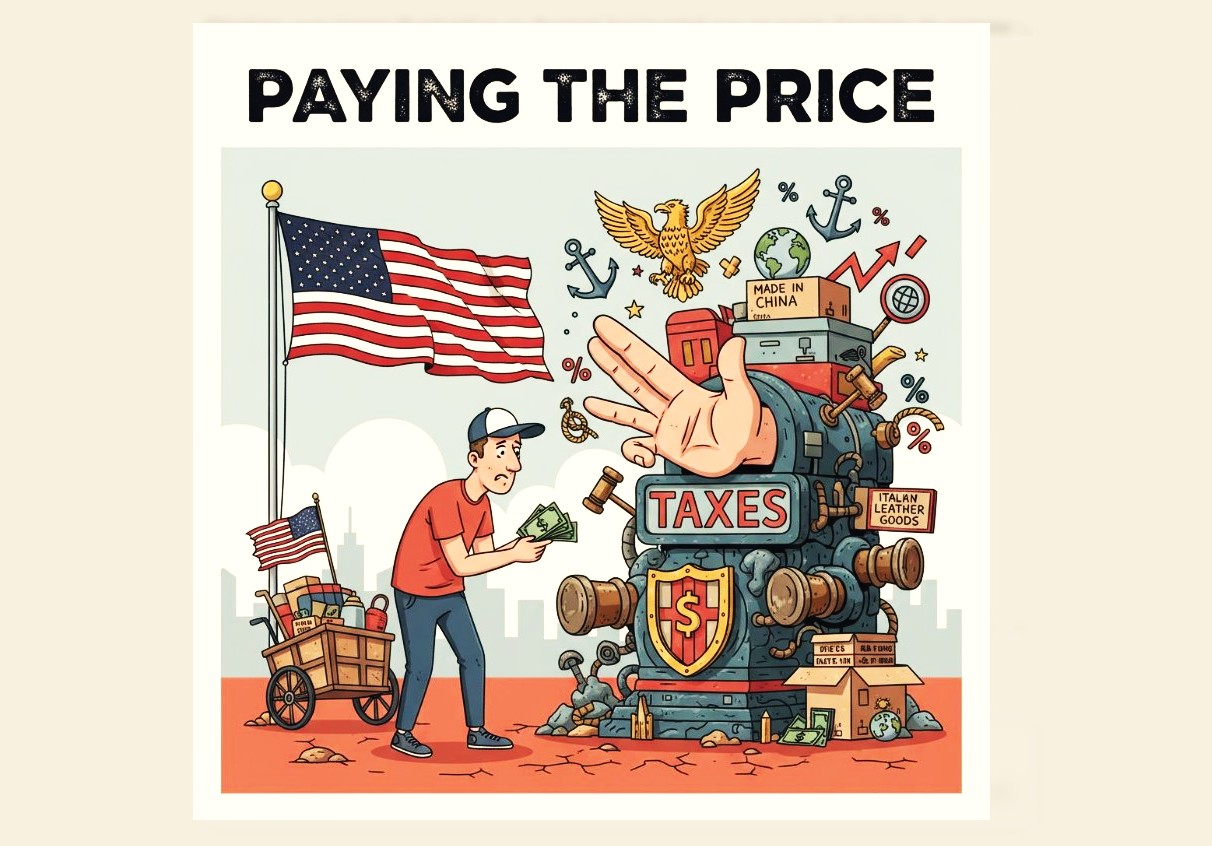Effet boomerang ! L’augmentation des droits de douane décidée par Trump frappe d’abord les entreprises et les consommateurs américains. Ce ne sont ni les exportateurs étrangers ni l'État américain, mais bien les acteurs économiques, qui supportent des coûts accrus à chaque achat ou importation. La facture est de taille et l’impact est tangible et multiple.
Une baisse des marges et une hausse des prix
Ces droits, pouvant atteindre jusqu’à 15% sur des voitures japonaises ou 100% sur certains semi-conducteurs, font exploser les coûts d’approvisionnement, notamment pour les industriels américains dépendant de fournisseurs en Chine, au Vietnam, au Chili ou en Europe. Les industriels américains voient ainsi leurs marges se réduire.
Si certaines entreprises tentent d’absorber ces hausses, d’autres répercutent ces coûts supplémentaires sur les prix finaux, augmentant ainsi le coût de la vie pour le consommateur américain. Cette « sneakflation » permanente contribue à une hausse généralisée des prix, frappant particulièrement les ménages modestes et réduisant le pouvoir d’achat des familles.
D’après une étude de l’université de Yale, cette surcharge douanière pourrait coûter en moyenne 3.800 dollars par an et par ménage, avec un impact plus fort sur les populations les plus pauvres, creusant davantage les inégalités sociales.
Une compétitivité fragilisée
Par ailleurs, cette politique tarifaire fragilise la compétitivité des entreprises américaines. Les PME, qui constituent la quasi-totalité des importateurs américains, sont particulièrement vulnérables. Elles souffrent davantage que les grandes entreprises des coûts accrus, des incertitudes logistiques et des retards qui allongent les chaînes d’approvisionnement. Ceci affecte leur trésorerie, limite leur capacité à innover, investir ou à rester compétitives sur leurs marchés souvent déjà fragiles comme l’énergie ou l’agroalimentaire.
Les grandes entreprises industrielles et technologiques ne sont pas non plus à l’abri. Certaines ont déjà vu leurs coûts augmenter de plusieurs centaines de millions de dollars en raison des droits de douane. Ces surcoûts pressurisent leur rentabilité et obligent souvent à transférer une partie des charges sur les consommateurs, participant à une inflation plus large et une ambiance économique incertaine.
L’augmentation des droits de douane est aussi source d’incertitudes juridiques et commerciales, entravant les contrats internationaux et rallongeant les délais de livraison.
Des mesures protectionnistes en cascade
Au-delà de l’économie interne des États-Unis, cette politique a des répercussions mondiales. En réponse, plusieurs pays ont instauré leurs propres mesures protectionnistes, accentuant les tensions commerciales et ralentissant la croissance mondiale. Selon les prévisions, la croissance américaine pourrait ralentir fortement, avec un risque de récession technique, tandis que celle du reste du monde, notamment en Europe et en Chine, est également impactée à cause de la réduction des échanges et des exportations vers les États-Unis.
Face à cette situation, la stratégie de diversification des sources d’approvisionnement et des marchés devient vitale pour les entreprises américaines. En diminuant leur dépendance à certains pays et en élargissant leurs réseaux de fournisseurs et clients, ces entreprises tentent de limiter les risques financiers et logistiques inhérents au protectionnisme. Néanmoins, cette adaptation est coûteuse, complexe, et longue, dans un contexte marqué par l’inflation et la volatilité géopolitique.
En résumé, la politique protectionniste de Trump, au-delà de ses objectifs affichés de réindustrialisation et de réduction du déficit commercial, génère des conséquences économiques fragilisantes. Elle accentue la pression sur les consommateurs et PME, nourrit une inflation latente, freine la croissance et pose des défis sociaux importants, notamment en creusant les inégalités.