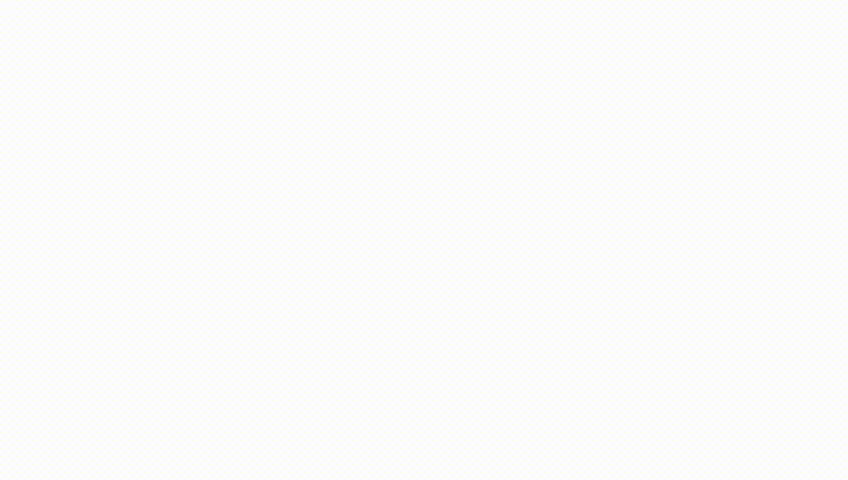Le tribunal de première instance de Bruxelles a rendu une décision historique en faveur d’une cycliste transgenre belge, exclue des compétitions féminines à la suite d’un durcissement du règlement de l’Union cycliste internationale (UCI). À l’origine de cette exclusion : de nouveaux critères médicaux imposés par l’UCI, soutenus par la fédération belge, qui conditionnaient l’accès des athlètes transgenres à la catégorie féminine à un taux de testostérone strictement encadré et à l’absence de puberté masculine. Cette mesure, visant à protéger l’équité sportive, était contestée pour son caractère général et son manque de fondement scientifique solide.
La justice belge rappelle le principe d’égalité
Saisie pour discrimination fondée sur l’identité de genre, la justice bruxelloise a jugé que priver une femme transgenre de compétition sur la base d’un tel règlement constituait une atteinte à la dignité et à l’égalité de traitement. Le tribunal a pointé le danger d’une application systématique de critères médicaux, validant l’argument que cela revient à stigmatiser une catégorie entière d’athlètes sans analyse individuelle ni consensus scientifique univoque.
L’UCI a ainsi été condamnée à indemniser la plaignante pour préjudice moral, et la fédération belge sommée d’adapter ses pratiques. Cette décision annule localement le règlement pour ce cas précis, tout en envoyant un signal fort sur la scène internationale.
Inclusion ou équité : le dilemme à trancher
Ce jugement relance un débat central dans le sport, celui des différences physiologiques entre personnes XX (femmes cisgenres) et XY (hommes cisgenres ou femmes transgenres ayant vécu une puberté masculine). En moyenne, les personnes XY développent à la puberté une masse musculaire, une densité osseuse et une capacité cardiorespiratoire supérieures à celles des personnes XX, sous l’effet de la testostérone. Par exemple, la masse musculaire représente 35% du poids corporel chez l’homme cisgenre, contre 28% chez la femme cisgenre, engendrant des performances sportives brutes en moyenne 10 à 12% supérieures chez les hommes selon les disciplines.
Cependant, les données récentes indiquent que les femmes transgenres ayant suivi un traitement hormonal abaissant la testostérone n’ont, après 12 mois, plus d’avantage net sur les femmes cisgenres pour la performance sportive d’élite. Cette réalité conduit à des positions divergentes : certains défendent que toute exclusion systématique reste une discrimination, tandis que d’autres soulignent la nécessité de préserver l’équité, quitte à justifier des règles spécifiques.
Un précédent pour la Belgique et l’Europe
Aux côtés de la plaignante, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes s’est constitué partie civile, saluant la portée de cette victoire au nom de l’inclusion et du respect des droits fondamentaux. La décision a été saluée par de nombreuses associations qui y voient une avancée décisive contre la transphobie, dans un contexte où les réglementations se durcissent à l’international.
Ce cas belge pourrait servir de modèle dans les futurs débats sur les règlements sportifs, rappelant que l’équité ne saurait primer sur l’inclusion sans fondement scientifique solide. La cycliste, désormais réintégrée dans la compétition féminine, espère que ce jugement inspirera d’autres athlètes trans confronté·es à la stigmatisation et à l’exclusion.