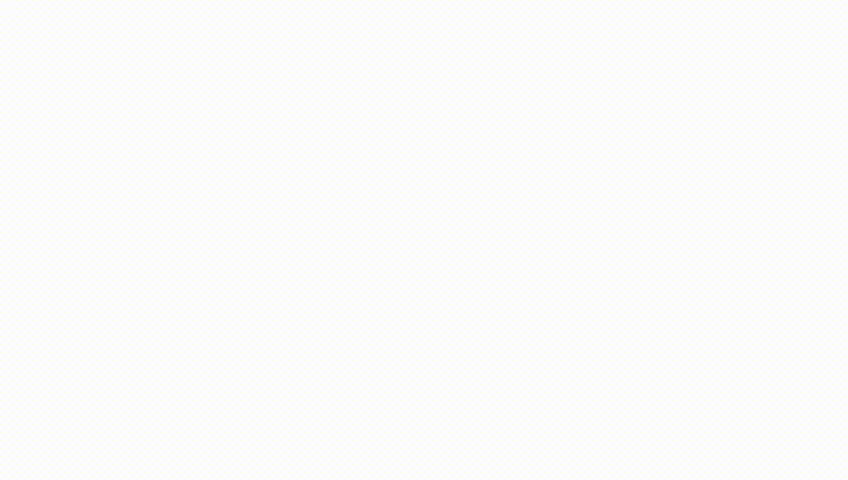Les relations entre les jeunes et les forces de l’ordre sont rarement au beau fixe. Preuve en est, l’actualité récurrente qui nous rappelle que les rapports sont jalonnés de difficultés cumulées. Entre amalgames d’un côté et provocations inutiles de l’autre, les périodes de confinements successifs n’ont certes pas été propices à l’apaisement. Les incertitudes, le stress et l’adrénaline associée ont démultipliées les incompréhensions et exacerbé les tensions entre les deux camps. Et pourtant, c’est oublier que leur histoire commune est depuis ses origines mêlée.
Dans les pays européens, les polices se sont instituées aux alentours du début du XIXème siècle pour faire face aux craintes suscitées par les jeunes hommes sans attaches errants dans les villes et les faubourgs qui connaissent, à l’époque, une forte croissance. Deux siècles plus tard, jeunesse et agents des forces de l’ordre restent comme intimement liés. Et pour cause. Dès la prime enfance, la police représente une figure structurante de l’autorité. Les enfants sont dans leur grande majorité fascinés par les policiers. A l’instar des pompiers, ils sont attirés par l’uniforme, comme par les gyrophares des auto-patrouilles, mais aussi par le côté prise de risques excitant associée à la fonction. Dans l’imaginaire collectif de l’adolescent ensuite, cette image positive se manifeste dans les productions culturelles, au premier rang desquelles le rap, mais aussi dans l’engouement réel pour certaines productions littéraires, cinématographiques et télévisées mettant en scène nos « justiciers ».
De ces projections symboliques, il en découle, adulte, que l’on exige inconsciemment du policier qu’il soit le surhomme de notre enfance. On voudrait qu’il prenne sur le fait le dealer de drogue de la cité, qu’il interpelle le vandale, qu’il retrouve le chauffard ou le homejacker. On voudrait aussi qu’il empêche les voisins de faire du bruit, qu’il gère une dispute familiale et qu’il ramène le fils en décrochage scolaire sur les bancs de l’école. Entre le maintien de la tranquillité et la répression des crimes et des délits, il existe peu de métiers qui soient autant exposés aux exigences du public.
Le surhomme n’étant toutefois qu’homme, cette représentation subliminale génère son lot d’effet pervers. L’image de la police se noircit quand ceux qui doivent faire respecter l’ordre anime le désordre. S’il est vrai que les bavures demeurent statistiquement l’exception, pour une bévue policière, c’est toute l’institution qui est mise en accusation. A l’inverse, il est surprenant de constater que malgré les erreurs médicales de certains praticiens, malgré les malversations de quelques avocats, sans compter les délits d’initiés et autres dérives dans le monde des affaires, ces groupes professionnels conservent une image de respectabilité presqu’intacte aux yeux du grand public.
Concilier l’ordre et les libertés est pourtant un périlleux exercice, presque d’équilibriste. Notre police est un des modes d’expression de l’autorité, mais elle est aussi gardienne de nos libertés fondamentales. En ce sens son action de prévention, afin d’éviter des situations susceptibles de déboucher sur une violation des règles, est tout aussi essentielle. Cette mission est pourtant beaucoup moins conscientisée par le public, a fortiori lorsqu’il est jeune, que son action apparente de répression. Il est vrai que sur grand écran, c’est rarement l’agent de quartier qui démantèle en loup solitaire invincible l'ensemble du cartel de Medellín après avoir traqué, en 3 saisons et 30 épisodes, Pablo Escobar. Les représentations sociétales de « Narcos » ont la vie dure.
Nos policiers ne sont pourtant pas des Mad Max. Ce diagnostic biaisé conduit notre jeunesse à ne pas percevoir l’utilité bienveillante d’une police de proximité, mais surtout à considérer cette dernière comme une institution contraignante créée pour l’ennuyer et faire obstacle, et non pour la servir et protéger. Revaloriser l’image préventive des forces de l’ordre et une représentation dissuasive de la fonction est un facteur déterminant pour améliorer son image actuelle d’un recours premier et exclusif à la force physique.
Mais qui dit jeunesse et incompréhension du côté du public, dit aussi jeunesse et impatience au sein des forces de l’ordre. Qui dit bouc-émissaires d’une part, dit aussi cow-boys un peu trop zélés de l’autre. Et c’est ici que vient se greffer une donne supplémentaire au passif du bilan relationnel. Même si l’on est en faute, mérite-t-on une approche brutale ? Même si l’on vit dans certains quartiers réputés difficiles est-on tous de facto à mettre dans « le même panier » ? De même, lorsque l’on se promène en rue, est-ce que l’on « traîne » forcément ? Tant que les jeunes auront l’impression qu’une certaine légèreté de jugements préconçus règne parmi certains policiers, essentiellement les nouvelles recrues, les discours positifs auront du mal à porter leurs fruits. Cette réalité doit impérativement être distillé dans les académies de police. La formation des policiers doit être orientée vers une meilleure gestion des aspects humains, dans le pluralisme, la diversité et le vivre-ensemble.
Force est de constater que le contentieux entre la police est les jeunes est devenu un enjeu public majeur. Parce que l’on ne génère le respect que si l’on offre du respect, l’équation est à deux inconnues. Des griefs s’affichent à l’évidence de part et d’autre. Victor Hugo nous rappelle pourtant qu’« ouvrir une école, c’est fermer une prison ». Il parlait du savoir et de la connaissance qui ouvrent les esprits. La proximité ne s’impose pas. Elle s’insuffle et se cultive. Préserver la paix sociale passe par l’éducation.
Une réflexion concertée entre le pouvoir politique, les forces de l’ordre, les acteurs sociaux de terrain et les enseignants s’impose pour dégager des solutions pédagogiques concrètes et créer un cadre de confiance retrouvée. A quand des actions concrètes ?