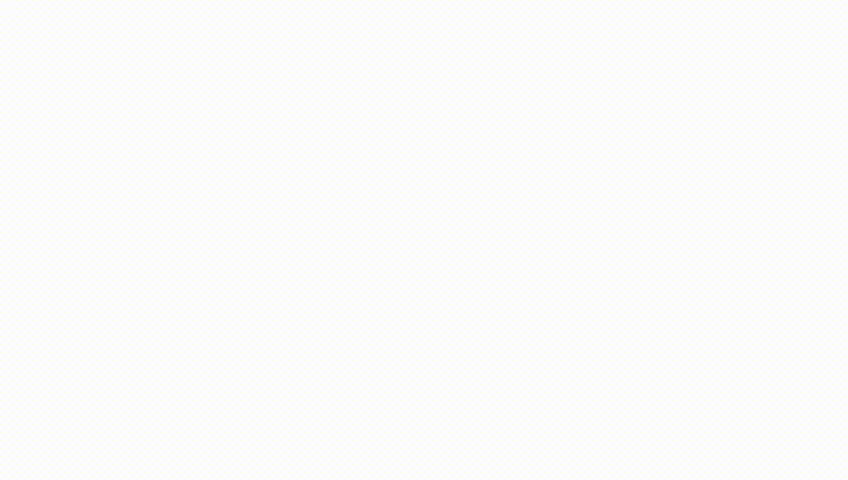L’avortement est-il menacé aux Etats-Unis ? C’est la question du jour. Un juge de la Cour suprême explique vouloir annuler l'arrêt historique Roe v. Wade, qui a consacré ce droit, en 1973, Outre-Atlantique. Une bonne part des conservateurs se fonde sur la prémisse suivant laquelle l’embryon est un être humain dès l’instant de sa conception. A force d’être traité sous l'angle moral ou religieux, le débat s’en trouve toutefois gangréné. Sous les feux de cette actualité, l’occasion m’est donnée de développer une argumentation rationnelle qui ne soit pas saturée, a priori, par des présupposés idéologiques aux contre-effets délétères.
Le raisonnement me semble devoir commencer par une question : quand l’embryon humain devient-il une personne ? Le débat philosophique ne date pas d’hier. Pendant longtemps en Occident, le critère déterminant a été le moment de l’ « animation », c’est-à-dire l’instant où l’on imaginait que l’âme entrait dans le corps humain. Aux antipodes, parmi moulte autres affirmations, pour Augustin d’Hippone, c’était à la première respiration. Aujourd’hui, les comités de bioéthiques s’accordent à dire que l’embryon est une « personne potentielle » soit un être qui deviendra une personne lorsqu’il aura acquis toutes les capacités constitutives de la personne. Sur le plan juridique, le même raisonnement se valide. En droit belge, l'embryon et le foetus n'ont pas de personnalité. Même si la loi prévoit un statut et des droits dans certaines conditions, l’enfant doit être né vivant et viable pour avoir « la personnalité juridique »
Cette indétermination du début de l’« être » induit que l’on opte médicalement pour une position restrictive dans la plupart de nos sociétés contemporaines. Il faut que des intérêts importants soient en jeu pour que l’on permette un avortement ou l’instrumentalisation des embryons dans le cadre de la recherche. On place aussi une limite temporelle précoce afin d’éviter de porter préjudice à un individu en devenir.
Ce cadre dressé, une seconde question, toute aussi majeure que la première, mérite une attention autre que déshumanisée. Trop polarisée entre les pour et les contre, la discussion sur l'avortement en oublie les principales protagonistes, celles qui le vivent dans leur chair. Contrairement aux étiquettes véhiculées ce n'est pas la panacée d'avorter. Ce n'est ni une partie de plaisir, ni une fête. On n'avorte pas sur un coup de tête. On n'avorte pas non plus par faiblesse, par bêtise ou par lâcheté. Cette euphorie est bien mal pensée. On avorte parce que l'on estime, en toute conscience et pour diverses raisons d’importance, que l'on ne peut mener à bien cette grossesse et, a fortiori, cette maternité.
Troisième question utile au cheminement de la pensée : la criminalisation des avortements les fait-elle disparaître ? L’Organisation mondiale de la santé (OMS) nous rappelle régulièrement que les tentatives d’interdiction ou de restriction ne font pas baisser leur nombre. Cette pénalisation les rend juste plus dangereux parce que pratiqués dans la clandestinité, à tel point qu’ils sont la troisième cause de mortalité maternelle à travers le monde : 22 millions d’avortements illégaux sont pratiqués chaque année.
À ce stade, il convient de se souvenir de notre hypothèse de départ qui a consisté à rappeler que l’embryon était du vivant, soit un être humain en devenir. Pratiquer un avortement n’est donc certainement pas synonyme de tuer une personne. Et rien de ce que j’ai dit ici ne contrevient à cette réalité. En revanche, priver les femmes du droit à l’avortement, c’est tout simplement priver celle qui avortent de la possibilité d’une nuance éclairée à la lumière d’histoires personnelles plurielles.
Parce que chaque IVG est différente, elle est loin d’être une option désincarnée de souffrances. Il y a urgence à expulser certaines idées préconçues. Stigmatiser revient à rajouter une peine à la peine. Respecter le droit à l’avortement dans une société pluraliste, dont les règles tendent à rejoindre les situations vécues par le plus grand nombre, est un devoir. Que cela ne rejoigne pas des positions convictionnelles à titre individuel relève du choix personnel. C’est oublier qu’une position dogmatique ne s’impose pas dans la sphère publique.