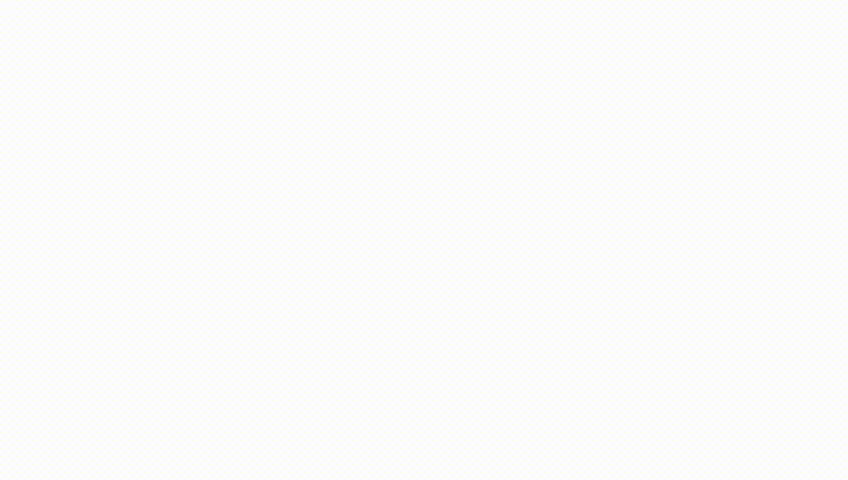La climatocratie est à l’œuvre à la Banque centrale européenne. Lors du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s’est tenu à Paris, ce 23 juin, Christine Lagarde, présidente de la BCE a affirmé que « le changement climatique a une incidence sur l’inflation » ! Comprenez donc : si mon compte bancaire est à découvert parce que les prix explosent et que le pouvoir d’achat diminue, c’est à cause du réchauffement climatique. Mais, certainement pas à cause de décisions politiques ubuesques qui nous enlisent dans des crises successives ! Avec un tel réductionnisme facile, l’argument verdurisé, à l’image du tailleur porté par la Dame – on joue même sur le subliminal - est béton et la cause exonératoire de responsabilité. « Greta a-t-elle tué Einstein ? », c’est la question que soulève Jean-Paul Oury, docteur en histoire des sciences. Pour l’auteur, « « le scientisme est utilisé pour installer la peur, déduire des normes, fixer des limites et décréter des interdits ». Et tout ceux qui ne valident pas la vision apocalyptique du GIEC sont censurés. Cette instrumentalisation de la science par l’écologique politique est particulièrement inquiétante dans l’Union européenne. L’Etat Vert décide désormais de tout. La dérive est totalitaire. N’en déplaise à l’écologisme politique, développement ne rime pas nécessairement avec pollution incontrôlable et régression. Bien au contraire, parce qu’il n’y a pas de décroissance heureuse, on peut poursuivre la réduction de nos émissions de CO2 sans culpabiliser, instrumentaliser, infantiliser et punir.
La crise énergétique apparue à l’été 2021, renforcée par le conflit russo-ukrainien, a démontré l’incohérence d’un Green Deal construit en filigrane de l’Energiewende allemand. Lieux-commun, tout le monde sait désormais que les objectifs 2030 (55% de GES en moins) et 2035 (fin de la fabrication des voitures thermiques) ne seront pas atteints. Mais, plutôt que de reconnaître ses erreurs, l’Europe accentue sa marche suicidaire en promouvant, par des effets d’annonce terrorisant, des pistes toujours plus délirantes et en imposant aux citoyens des cordons de la bourse de plus en plus serrés. C’est ce que l’on appelle faire de l’écologie « collapsologique » : la décroissance serait le seul levier crédible pour éviter la catastrophe ultime.
Et pourtant, « voilà deux siècles que la civilisation industrielle libère les hommes de la misère. Mais les apôtres de l'écologie radicale accusent les sociétés modernes d'avoir acheté leur confort au détriment de l'environnement, quitte à dépeindre le passé comme le paradis perdu qu'il n'a jamais été », nous rappelle l’analyste politique Ferghane Azihari. Mêlant histoire, philosophie et analyses sociopolitiques, il déconstruit dans « Les écologistes contre la modernité – Le procès de Prométhée », les raisonnements de ces antimodernes, de Pierre Rabbhi à Greta Thunberg, en passant par Nicolas Hulot, franchement hostile au progrès des sociétés industrielles avancées. Ceux-là même qui qui crient au drame, mais font la guerre aux solutions les plus crédibles aux défis actuels, comme l'est par exemple l’énergie nucléaire.
C’est occulter une variable d’ajustement : le progrès technique reste le moyen le plus juste, et le seul, pour sauvegarder notre planète, sans renoncer à améliorer le sort de l'humanité. En ce sens, l'écologie politique n’est pas animée par la philanthropie, mais par le despotisme. Rien de bien étonnant ! N’oublions pas que, de tous temps, le totalitarisme a toujours instrumentalisé la science pour satisfaire ses agendas idéologiques. Une instrumentalisation résultant d’un étonnant regard sélectif sur les lois de la physique : j’amplifie ce qui me convient et j’oublie, ou mieux, j’interdis ce qui ne me convient pas …
Source : Ferghane Azihari, analyste en politiques publiques, est délégué général de l'Académie libre des sciences humaines et membre de la Société d'économie politique. Il publie notamment dans Le Figaro et est contributeur du think tank américain Ludwig von Mises Institute.