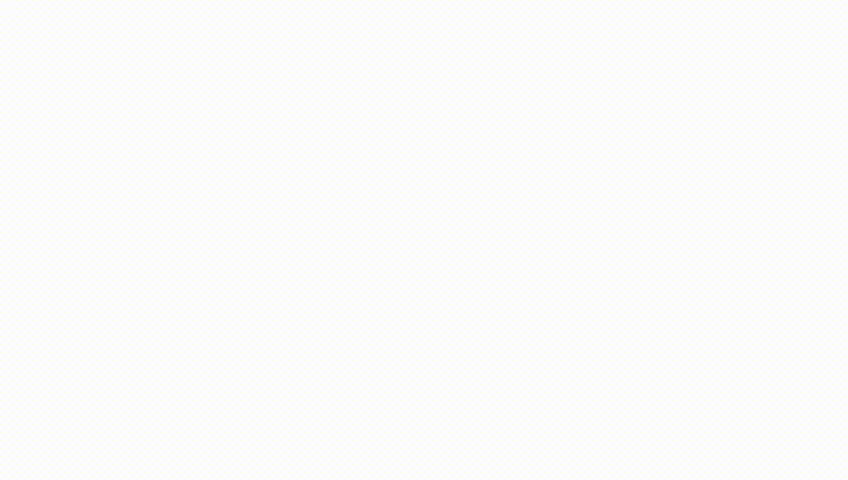Depuis le début du conflit russo-ukrainien, l’Union européenne affiche une unité sans faille dans son soutien à l’Ukraine. Mais selon l’analyste Philippe Béchade, loin de chercher une issue rapide, certains dirigeants européens, au premier rang desquels le très antirusse Friedrich Merz, chef de la CDU allemande, privilégient la poursuite de la confrontation avec la Russie, en particulier à travers le soutien militaire à l’Ukraine. Analyse d’une stratégie qui fait débat.
Soutien militaire massif et ligne dure
L’Union européenne affiche, depuis 2022, une unité sans faille dans son soutien à l’Ukraine, condamnant fermement l’agression russe et multipliant les sanctions contre Moscou. L’UE a adopté de multiples trains de sanctions, fourni une aide militaire, économique et humanitaire massive, et répété son engagement à soutenir l’Ukraine « aussi longtemps qu’il le faudra ». Cette stratégie vise explicitement à empêcher la Russie de l’emporter sur le terrain et à affaiblir durablement ses capacités militaires et économiques.
Le rôle de Friedrich Merz
Le chancelier conservateur Friedrich Merz se distingue par une position nettement plus offensive que son prédécesseur Olaf Scholz, soit intensifier la pression sur la machine de guerre russe. Alors que Scholz a longtemps refusé la livraison de missiles de croisière Taurus à l’Ukraine par crainte d’une escalade, Merz s’est prononcé à plusieurs reprises en faveur de cette livraison, estimant que l’Ukraine devait sortir de la défensive et pouvoir frapper des cibles stratégiques russes, comme le pont de Kertch. Il a qualifié les attaques russes de « crimes de guerre » et considère que la faiblesse ou les offres de paix ne sauraient amener Poutine à négocier.
Selon Philippe Béchade, cette posture traduit une volonté européenne de maintenir la pression sur la Russie, quitte à prolonger le conflit. L’objectif : empêcher toute victoire russe et affaiblir Moscou sur la durée.
Des nuances à apporter
Cependant, il convient de nuancer cette interprétation. L’UE a aussi proposé à plusieurs reprises des cessez-le-feu et des ouvertures diplomatiques, notamment lors de la visite conjointe de plusieurs dirigeants européens à Kiev en mai 2025, où ils ont réclamé un « cessez-le-feu complet et inconditionnel » de 30 jours à Moscou, une initiative conjointe majeure des dirigeants français, allemand, britannique et polonais. Cela montre que, malgré leur soutien militaire, les Européens ne ferment pas la porte à une solution négociée. L’Europe souhaite néanmoins une « paix juste et durable » reposant sur le respect de la souveraineté et de la territorialité de l’Ukraine.
En résumé, l’unité européenne affichée est tiraillée par des débats internes sur la meilleure stratégie : certains pays privilégient une pression maximale sur la Russie, d’autres s’inquiètent d’un enlisement du conflit et des conséquences économiques et sécuritaires pour l’UE.
Quant à Donald Trump, avec qui il faut compter, il a affiché publiquement son impatience face à Moscou. Les États-Unis insistent sur la nécessité de négocier rapidement la fin du conflit, considérant que la question n’est plus de savoir si la guerre doit finir, mais comment. De quoi y réfléchir à deux fois du côté de Kiev. L’aide américaine à l’Ukraine a été drastiquement réduite, passant à zéro pour les nouveaux engagements depuis janvier 2025. Les livraisons en cours sont issues de décisions prises sous l’administration Biden et devraient s’achever à l’été 2025.
De son côté, Poutine ne lâche rien. Il souhaite les quatre territoires ukrainiens annexés en 2022 + la Crimée. Et n’a jamais demandé autre chose que la démilitarisation de l’Ukraine et la garantie que les forces de l’OTAN s’éloignent le plus possible de la Russie.