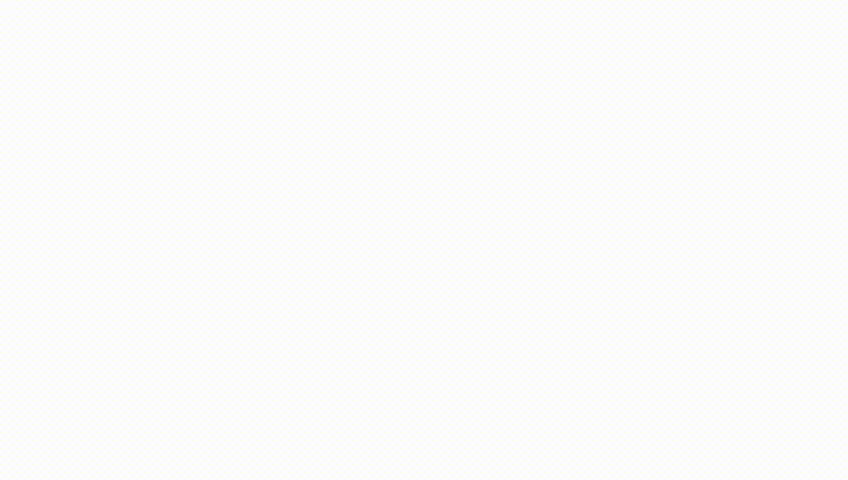Le premier coup de feu de la guerre commerciale sino-américaine fut tiré en 2018, lorsque les États-Unis imposèrent une hausse substantielle des droits de douane sur de nombreux produits chinois, tout en accusant Pékin de pratiques commerciales déloyales, telles que des transferts forcés de technologie et des violations répétées de la propriété intellectuelle. « Nous ne voulons pas d'une guerre commerciale, mais nous n'avons pas peur d'en mener une ! », avait alors déclaré Pékin en ripostant avec une liste de visant des produits américains stratégique à taxer. Loin d’être un épisode révolu, le conflit a connu une escalade majeure début avril 2025.
Une liste chinoise des « entités non fiables »
Washington a porté ses droits de douane à un niveau record de 145% sur la plupart des importations chinoises, même si certains produits électroniques ont été temporairement exemptés. En riposte immédiate, la Chine a relevé ses propres tarifs douaniers sur les produits américains à 125%, marquant ainsi une surenchère sans précédent entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.
Pékin a également suspendu certaines importations agricoles stratégiques, comme le soja et le maïs, et multiplié les enquêtes anti-dumping visant des entreprises américaines, notamment dans la tech. À cela s’ajoutent des mesures de contrôle renforcées sur les exportateurs américains et l’ajout de plusieurs sociétés à la liste chinoise des « entités non fiables ».
Une stratégie d’autonomie technologique
La Chine accélère aussi son autonomie. Le plan « Made in China 2025 », lancé en 2015, s’intensifie avec pour objectif de réduire la dépendance technologique vis-à-vis de l’Occident, en particulier dans des secteurs clés comme les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et les énergies renouvelables. En 2024, l’Empire du Milieu a investi 1,4 trillion de yuans (environ 200 milliards de dollars) dans la recherche et le développement, soit une augmentation de 10% par rapport à l’année précédente. Le message du ministre chinois du Commerce, Weng Wentao, est sans ambiguïté : si les États-Unis persistent dans l’unilatéralisme et l’intimidation, la Chine « se battra jusqu’au bout pour défendre ses droits légitimes ».
Maintenir le cap malgré les incertitudes
Pour l’heure, la guerre commerciale n’a eu qu’un impact limité sur la croissance chinoise, qui a atteint 5,4 % au premier trimestre 2025, et les exportations totales ont atteint un niveau record de 3,4 trillions de dollars. Cependant, certains secteurs fortement dépendants du marché américain, comme l’électronique et le textile, commencent à souffrir de la baisse des commandes, alors que la consommation intérieure reste fragile. Zheng Shanjie, chef de la planification économique, a reconnu en mars 2025 que « l’incertitude de l’environnement extérieur s’accroît, et nous faisons face à une demande intérieure insuffisante ». Pour soutenir l’économie, Pékin a annoncé une hausse des dépenses publiques de 6% en 2025, afin de stimuler l’investissement et la consommation. Le secteur immobilier, en crise depuis 2021, reste un point faible majeur, avec une dette des promoteurs estimée à plus de 1,2 trillion de dollars, faisant planer le risque d’une crise financière interne.
Vers un compromis partiel ?
Malgré ces défis, Xi Jinping réaffirme son ambition de faire de la Chine une « puissance technologique mondiale » d’ici 2035, peu importe les obstacles dressés par les États-Unis. Si l’escalade tarifaire fragilise certains secteurs et accentue les incertitudes, la stratégie officielle consiste à afficher confiance, résilience et détermination à ne pas céder face à la pression américaine. L’avenir du commerce mondial, quant à lui, reste suspendu à l’évolution de ce bras de fer inédit entre les deux géants. À plus long terme, la guerre commerciale pourrait accélérer le découplage économique entre les deux pays, même si l’interdépendance demeure forte. Certaines multinationales, comme Apple, envisagent de transférer une partie significative de leur production hors de Chine, notamment vers l’Inde, signe d’une reconfiguration des chaînes d’approvisionnement mondiales. La pression pour trouver au moins un compromis partiel va devenir extrêmement forte.