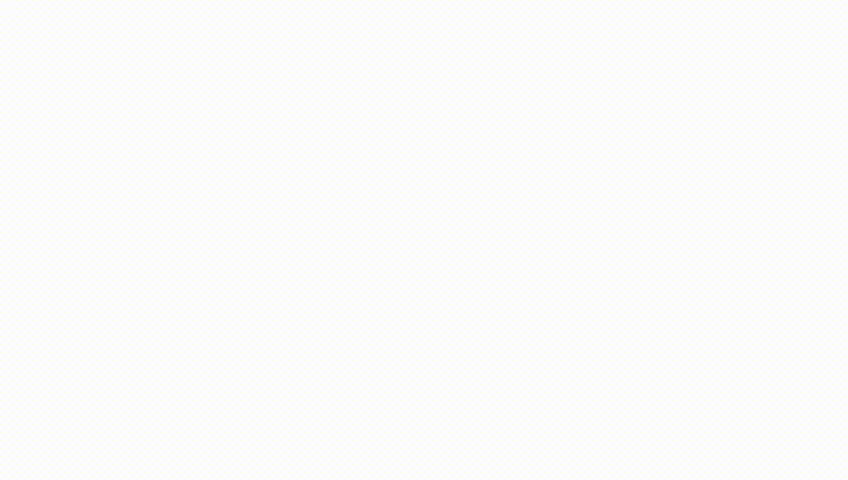Le pape François est décédé à l’âge canonique de 88 ans (2013-2025). Son règne restera comme l’un des plus controversés de l’histoire contemporaine de l’Église catholique. Premier pape jésuite et premier pontife issu d’Amérique latine, il a déplacé le centre de gravité de l’Église vers le Sud global, tout en projetant une image de défense des pauvres. Mais derrière ce vernis progressiste, son pontificat a été traversé par de profondes ambiguïtés, tant sur le plan idéologique que dans la gestion des grandes crises morales de l’Église.
Un héritier de la théologie de la libération, mais à sa manière
François s’inscrit dans la lignée de la théologie de la libération - longtemps marginalisée sous Jean-Paul II et Benoît XVI - un courant né en Amérique latine dans les années 60 qui prône l’option préférentielle pour la lutte contre l’injustice sociale, avec des accents communistes dans ses analyses des rapports de domination. Toutefois, il s’est toujours gardé d’embrasser la dimension révolutionnaire de ce courant, préférant une version « non marxiste » centrée sur la dignité humaine et la solidarité. Il a ainsi favorisé une Église « pauvre pour les pauvres », refusant les fastes du pouvoir, et multiplié les gestes symboliques en faveur des exclus et des victimes de la mondialisation.
Ce positionnement lui a permis de rallier une partie de la gauche catholique et des mouvements sociaux, notamment sur la question de l’accueil des migrants, tout en conservant une distance prudente vis-à-vis des discours explicitement politiques.
Avortement et homosexualité : oui, mais non…
Malgré cette image progressiste, François est resté fidèle à la doctrine catholique sur des sujets comme l’avortement. Il n’a jamais remis en cause la condamnation de l’IVG, allant jusqu’à qualifier les médecins pratiquant l’avortement de « tueurs à gages » et saluant le refus du roi Baudouin de signer la loi belge sur l’avortement comme un acte de sainteté. Cette intransigeance a relancé les polémiques, notamment en Europe occidentale, et révélé la ligne de fracture entre l’humanisme social du pape et le conservatisme moral de l’Église.
Sur l’homosexualité, François a adopté une posture d’ « ouverture pastorale » sans toucher au fond de la doctrine. Il a autorisé la bénédiction des couples de même sexe, à condition de ne pas les confondre avec le mariage, tout en maintenant que l’homosexualité reste un « désordre » selon la doctrine officielle. Cette position médiane - soit tenir ensemble entre miséricorde et fidélité à la tradition - a hérissé les conservateurs sans satisfaire pleinement les progressistes.
Abus sexuels : du verbe à l’action, mais jusqu’où ?
L’un des plus grands défis de son pontificat a été la lutte contre les abus sexuels dans l’Église. D’abord prudent, François a fini par ouvrir le dossier, dénonçant la « complicité inexplicable » et encourageant l’indemnisation des victimes. Mais cette volonté affichée de « transparence » s’est heurtée à des contradictions, notamment dans la gestion de certains dossiers sensibles, comme celui du prêtre Marko Rupnik, pour lequel il aurait levé une excommunication malgré de graves accusations d’abus. Si le pape a indéniablement fait progresser la prise de conscience, son action reste jugée incomplète.
Un balancement permanent
Le règne du pape François restera certes celui d’un pape « des périphéries », soucieux de replacer les pauvres au cœur de l’Église en dénonçant les dérives du capitalisme mondialisé. Mais cette posture s’est accompagnée de balancements idéologiques notables, entre fidélité à la tradition sur les questions morales et volonté d’ouverture sur les sujets de société. Plus qu’un révolutionnaire, François aura été un funambule, cherchant sans cesse à concilier l’inconciliable dans une Église catholique profondément divisée, naviguant dans une oscillation en permanence entretenue et perçue par d’aucun comme de l’ambiguïté ou de l’opportunisme.