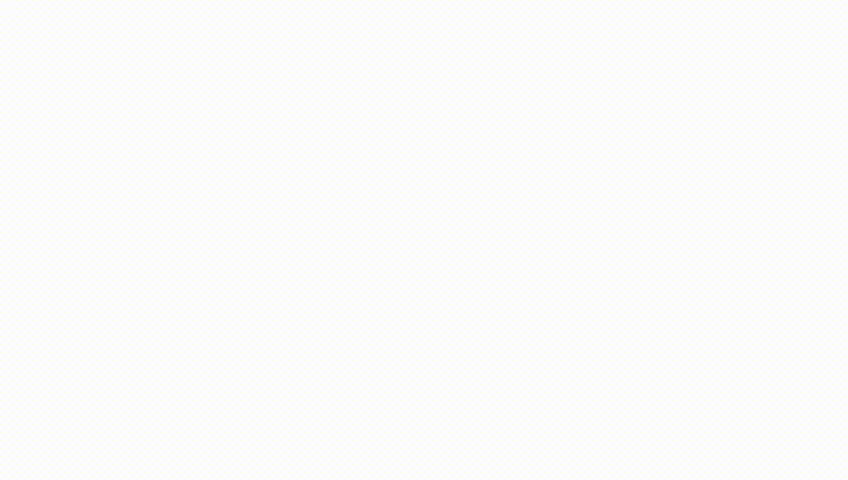La Belgique fait face à un désastre carcéral d’une ampleur inédite : la surpopulation en les murs dépasse de 25% le nombre de places disponibles. Cette situation, dénoncée de longue date par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) engendre des conditions de détention indignes, complique la réinsertion et met sous pression le personnel pénitentiaire, régulièrement en grève face à l’impossibilité de remplir correctement sa mission. Malgré les multiples alertes, la réponse politique se limite à l’extension du parc carcéral. Au bord de la rupture, le pays est otage du « tout sécuritaire ». La crise est systémique.
La réforme des courtes peines : le cœur de la crise
Depuis le 1er septembre 2022, sous l’impulsion de l’ancien ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, la Belgique a commencé à exécuter systématiquement les peines de prison de 2 à 3 ans, mettant ainsi fin à une politique de non-exécution des courtes peines en vigueur depuis près de 50 ans. Cette politique dite de « tolérance zéro » a été étendue à partir du 1er septembre 2023 : toutes les peines de prison comprises entre 6 mois et 2 ans doivent désormais également être effectivement exécutées.
L’objectif affiché d’une telle mesure ? « Lutter contre le sentiment d’impunité » dans l’opinion publique lié à la non-exécution des courtes peines et « restaurer la confiance dans la justice ». Or, comme le souligne Manuela Cadelli, juge au tribunal de première instance de Namur et administratrice de l’Association syndicale des magistrats, la surpopulation actuelle est directement liée à cette réforme sur l’exécution des courtes peines. Le bilan ? Une augmentation mécanique du nombre de détenus, sans réflexion préalable sur les capacités d’accueil ou les alternatives existantes à l’incarcération.
L’incarcération massive : un non-sens
Un constat partagé, le 18 avril dernier, dans un rapport du Conseil central de surveillance pénitentiaire : « Nos prisons craquent sous la surpopulation. Plus de 13.700 détenus (au 31 mars 2025, 12.976 détenus en cellule et 713 en congé pénitentiaire prolongé) pour 11.040 places disponibles. Cette surpopulation expose les détenus à des traitements inhumains ou dégradants, et met en péril l’objectif même de la peine : permettre une réinsertion dans la société dans des conditions dignes, à la fois pour la personne condamnée, pour la sécurité publique et pour les citoyens ». L'exécution systématique des courtes peines a généré une hausse de 40% de la population carcérale en trois ans, directement liée à l'incarcération massive des condamnés à de courtes peines.
Contreproductif en termes de récidive
Par ailleurs, cette politique n’a eu aucun impact sur la récidive qui reste toujours élevée (3 détenus sur 5, soit 60%). Les alternatives à la détention (travaux d'intérêt général, surveillance électronique, etc.) réduiraient pourtant de 50% le risque de récidive comparé à l’exécution systématique des courtes peines. Impacte en effet sur les courtes peines l’effet criminogène de l’incarcération.
La crise actuelle met en lumière l’urgence d’une réforme globale de la politique pénale belge, qui reste sourde aux expériences étrangères. Contrairement à la Belgique, certains pays européens ont en effet réussi à réduire leur population carcérale sans voir la criminalité augmenter. Les Pays-Bas en sont un exemple. Ils ont divisé par deux leur nombre de prisonniers en dix ans, fermant massivement leurs établissements pénitentiaires. Cette décroissance n’est pas le fruit d’une politique de dépénalisation massive, mais plutôt d’une évolution des pratiques policières et judiciaires. Les Pays-Bas comptent aujourd’hui 54 prisonniers pour 100.000 habitants, soit près de deux fois moins que la France et bien moins que la Belgique.
La crise actuelle de la surpopulation carcérale belge, exacerbée par l’instrumentalisation politique de la question, révèle l’impasse d’une politique pénale centrée sur l’incarcération. L’exemple des Pays-Bas et les recommandations des experts et acteurs de terrains convergent : il est temps d’engager une réforme structurelle plus efficace pour la sécurité de chacun, fondée sur la limitation des peines privatives de liberté, le développement d’alternatives et un investissement massif dans la réinsertion. Faute de quoi, la Belgique continuera à s’enfermer dans une spirale inefficace et extrêmement coûteuse pour la Justice et le contribuable, au détriment des droits fondamentaux et de la cohésion sociale.