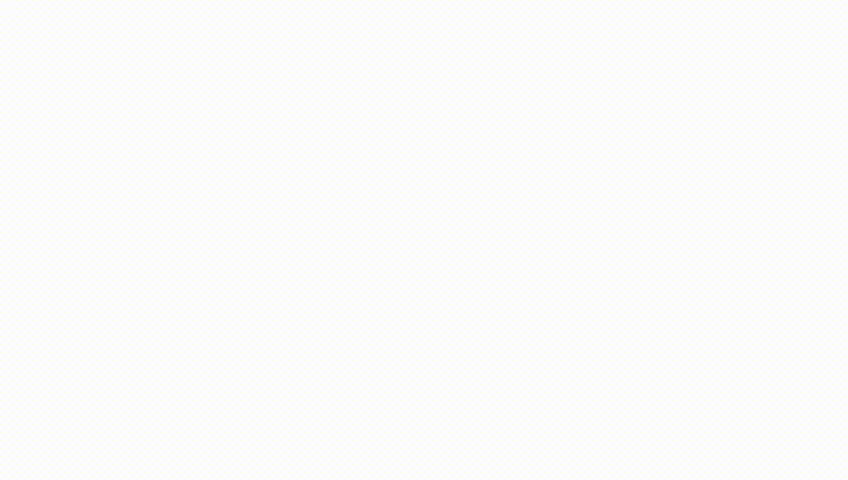C’est le buzz musical de l’été. Alors qu’il se produisait dans une brasserie branchée de Berne, le groupe Lauwarn est contraint d'interrompre son concert. Il est depuis au cœur d'une polémique qui voudrait voir les dreadlocks des musiciens coupées. Ce mardi 16 août, c’est un bar à Zurich qui a renoncé au dernier moment à faire jouer le guitariste autrichien Mario Parizek qui porte lui aussi des dreadlocks alors qu’il est blanc. Le débat capillaire prend désormais une tournure politique. Des jeunes militants de l'UDC Suisse (Union démocratique du centre, un parti politique suisse conservateur et nationaliste) ont pris le contrepied. Ils ont annoncé vouloir saisir la justice pour « racisme antiblanc ». L’affaire des rastas blancs relance la question de l’appropriation culturelle. Mais, qu’est-ce que le « blackfishing » et existe-t-il dans l’industrie musicale ?
Le 18 juillet dernier, le groupe suisse de reggae Lauwarm devait se produire à la Brasserie Lorraine de Berne, un lieu alternatif de gauche. Le groupe est arrivé en portant des vêtements africains et des dreadlocks. Ces attributs ont dérangé une partie de l’assistance. « Plusieurs personnes ont exprimé un malaise face à cette situation », écrit l’établissement sur sa page Facebook, où il a rendu l’incident public le 25 juillet dernier. L’histoire va se répéter. Mardi 16 août, le guitariste autrichien Mario Parizek a vu son concert annulé, cette fois dans un bar zurichois, mais pour les mêmes raisons. La question de l’appropriation culturelle suscite des discussions animées en Suisse. Petite tentative de clarification.
« Blackfishing » ou échange culturel ?
Le terme d'appropriation culturelle a été mentionné pour la première fois dans un article d'Arthur E. Christy datant de 1945. Ce n'est que dans les années 1980 qu’il a été utilisé à plus large échelle, lorsque le concept de « colonialisme culturel » a commencé à occuper le devant de la scène académique. Dans un premier temps, l’expression est restée confinée au domaine académique pour finir ensuite par s’imposer dans la culture populaire. Selon la définition de l’Encyclopaedia britannica, « il y a appropriation culturelle lorsque les membres d'un groupe majoritaire adoptent des éléments culturels d'un groupe minoritaire de manière abusive, irrespectueuse ou stéréotypée ».
L'appropriation culturelle a donc toujours un lien avec un rapport de force quelconque, comme le soulignait déjà, en 2003, l'écrivain et musicien américain Greg Tate dans son ouvrage Everything but the burden: what white people are taking from black culture (NDLR : Tout sauf le fardeau : ce que les Blancs prennent de la culture noire). L’appropriation culturelle doit être distinguée de l'échange culturel entre partenaires qui se trouvent sur un pied d'égalité.
Le reproche fait à l’industrie musicale
Dans l’univers musical, le reproche d’appropriation culturelle est ancien. Historiquement, être blanc est un facteur favorisant les artistes au même titre que dans le reste de la société. C’est ce white privilege qui a suscité de vives critiques quant au succès d’Elvis Presley qui a connu la gloire, entre autres, grâce à des inspirations musicales noires des années 1950-1960. Plus proche de nous, le rappeur blanc Eminem a également été impliqué dans le débat, tout comme le groupe de reggae britannique UB40. C’est dans ce contexte que le sociologue Henri-Michel Yéré, chercheur en sciences sociales à l’Université de Bâle, a récemment tenu à préciser à la télévision alémanique SRF que « l’appropriation culturelle consistait à jouer sur un aspect culturel en tant que cliché, sans respect pour l’histoire de la minorité concernée ».
Une ethnicisation de la culture
Le guitariste autrichien Mario Parizek est le dernier artiste pointé du doigt. L’annulation de son concert dans un bar zurichois lui a été signifiée par les organisateurs ce mardi 16 août. Il a immédiatement empoigné son smartphone pour diffuser sur Instagram une prise de position filmée, confirmant que la décision avait été prise car il portait des dreadlocks alors qu’il est blanc. Dans sa vidéo, il explique porter des dreadlocks depuis l’âge de 13 ans parce qu’il avait grandi dans un village « de droite » et qu’il voulait montrer « à ces gens de droite » qu’il existait d’autres types de personnes. « Aujourd’hui, je suis discriminé par la gauche », estime-t-il
Harald Fischer-Tiné, professeur à l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) s’intéresse depuis des années à l’histoire du colonialisme et de l’impérialisme. Du résultat de ses recherches, l’indignation face à l’appropriation culturelle repose chez ses défenseurs sur une hypothèse de départ : les cultures sont « pures ». Partant, des styles musicaux « asiatiques », « noirs » ou « blancs » ne devraient pas se mélanger. « Or, les critiques de l’appropriation culturelle reposant sur ce postulat favorisent l’ethnicisation de la culture et alimentent les cloisonnements », souligne -t-il dans le quotidien vaudois 24 heures.
Pas question de couper les dreadlocks
L'équation « Blancs + dreadlocks = appropriation culturelle » est donc un peu trop simpliste, d'autant plus que cette coiffure n'est pas historiquement réservée aux personnes de couleur noire. Si le mot a effectivement été inventé en Jamaïque dans les années 40, il désigne une coiffe naturelle, dont l’origine se perd dans la nuit des temps et dont les premières traces dans les livres d’histoire remontent aux … vikings. Ces tresses apparaissent aussi dans de nombreuses autres cultures, comme chez les Aztèques ou dans la culture hindoue. Les dreadlocks sont devenues par la suite seulement populaires dans le monde entier grâce à la culture rastafari de la Jamaïque et à son représentant le plus connu, la star du reggae Bob Marley.
Dans le prolongement de la récente polémique, par l’intermédiaire de son chanteur Dominik Plumettaz, le groupe Lauwarn a affirmé dans les colonnes du média suisse Le Temps. « Je trouve qu’il est important de débattre de l’appropriation culturelle. Même si j’ai une préférence pour ce que nous faisons au travers du terme d’inspiration. Nous faisons du reggae en Bärndutsch [allemand bernois, ndlr] avec nos textes et non pas avec des textes empruntés à la culture jamaïcaine ou à Jah Rastafari. Nous respecterons toutes les cultures, mais nous ne couperons pas nos dreads ».