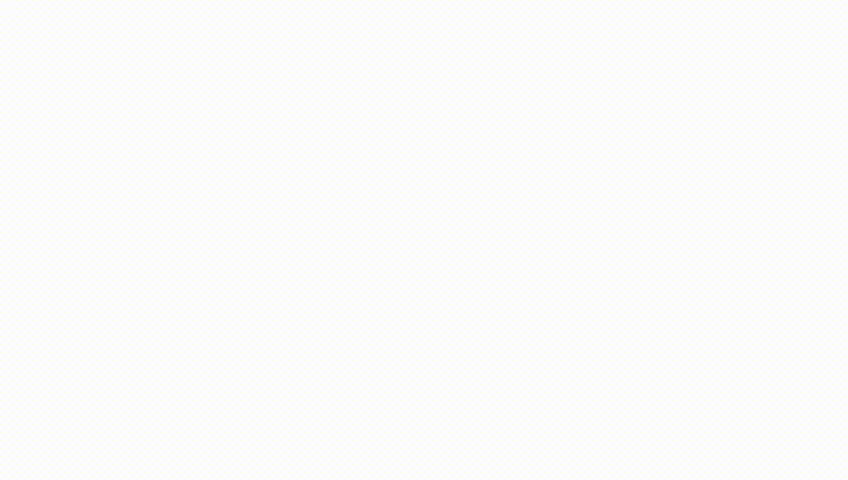Peut-on porter le voile en France sur un terrain de football ? Sous les hashtags #LetUsPlay #FootBallPourToutes, c'est un bras de fer qui opposait depuis des années le collectif des Hijabeuses autoproclamées, constituées en 2020 en syndicat de footballeuses musulmanes, et la Fédération française de football (FFF) alors que la FIFA autorise le port du voile depuis 2014, le considérant comme un signe culturel et non religieux. La levée potentielle de cette interdiction avait suscité une levée de boucliers dans la classe politique française. L’administration a tranché ce 29 juin. « Les fédérations sportives, chargées d'assurer le bon fonctionnement du service public dont la gestion leur est confiée, peuvent imposer à leurs joueurs une obligation de neutralité des tenues lors des compétitions et manifestations sportives afin de garantir le bon déroulement des matchs et prévenir tout affrontement ou confrontation », a précisé le Conseil d’État dans un communiqué. Les Hijabeuses ont perdu la partie. Il n’y aura pas d’importation dans le football de revendications communautaires. Interdire le port du hijab n’est en rien une atteinte aux droits des femmes, alors que des Iraniennes et des Iraniens meurent par centaine pour arracher le voile.
Rétroactes
Founé Diawara, la présidente des Hijabeuses et footballeuse, a pris la tête du mouvement à ses prémices. Elle se souvient très bien de ce match de 2015, lorsque l’arbitre lui a demandé d’enlever son voile car, contrairement aux règles de la FIFA, l’article 1 des statuts de la Fédération française de football (FFF) « interdit tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale » lors des compétitions officielles. Exclue pour avoir refusé de l’enlever, Founé Diawara a suivi le jeu depuis le banc. C’est là que son refus est devenu militant. Une centaine de femmes fédérées autour de la jeune étudiante en Sciences PO, revendiquaient depuis le droit de jouer au football en compétition tout en portant le hijab. Elles contestaient par ailleurs le fait que le port du voile soit interdit « pour cause d'hygiène et de sécurité », alors qu'il est autorisé dans des sports de contact tels que le karaté, le basketball ou le handball.
Le hijab, pas qu’un vêtement
Dans sa plaidoirie, Frédéric Thiriez, avocat au Conseil d'État et intervenant pour la Ligue du droit international des femmes (LDIF), avait affirmé que, pour cette dernière, le hijab n'est « pas seulement signe d'appartenance mais un signe de soumission, un apartheid sexuel ». La requête déposée par le collectif des Hijabeuses est « loin d'être un mouvement spontané de jeunes femmes mais résulte d'une offensive de l'islamisme politique (…). Il oppose ce combat à celui d'athlètes iraniennes souhaitant se libérer de l'obligation de porter le voile. Ce sont elles qui défendent la liberté et non pas les Hijabeuses ». Comment le hijab peut-il être un signe de soumission en Iran et une manifestation de liberté en France ? Notre société démocratique n’a aucune raison de céder ou de s’adapter à cette vision intégriste et radicale, sauf à renier ses principes laïques et ses idéaux émancipateurs.
Une proportionnalité respectée
Lors de cette même audience, le rapporteur public, qui dit le droit et dont l’avis est généralement suivi, avait invoqué le concept de « service public » et avait proposé l’annulation de l’article 1 du règlement de la fédération qui prohibe, depuis 2016, « tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale ».
Dans sa décision, le Conseil d’État estime que les joueuses sont bien des usagères d’un service public et donc pas soumises au devoir de « neutralité », mais que la Fédération française de football (FFF) peut édicter les règles qu’elle estime nécessaires au « bon déroulement » des matchs. L’interdiction édictée par la FFF est donc « adaptée et proportionnée ».