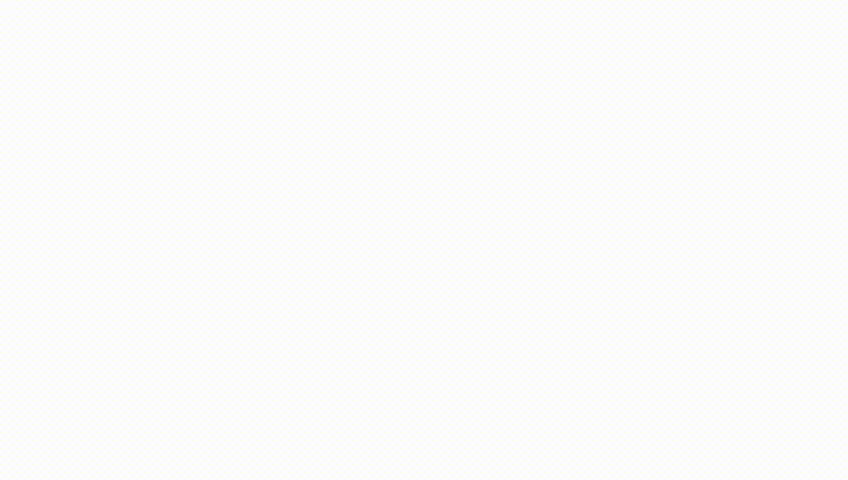« Le pic du wokisme est-il derrière nous ? », s’interrogeait l’éditorialiste conservateur du New York Times, Ross Douthat, quelques jours avant les attaques du Hamas. Le mouvement montre à tout le moins aujourd’hui des signes évidents d’essoufflement. Mais, au-delà de sa moraline injectée à doses massives, c'est peut-être sur le plan économique qu’il rencontre ses plus grandes difficultés. Les entreprises constatent que l'adoption d'une posture woke a un impact négatif sur leurs résultats financiers. Elles rétropédalent sèchement.
Un dessin vaut mieux qu’un piètre discours
Autrefois champion des causes « progressistes », Disney connaît plusieurs échecs cuisant récents au box-office, notamment avec The Marvels et Wish. Face à un accueil critique, la série Star Wars « The Acolyte », centrée sur des personnages au wokisme assumé, a aussi été annulée après une seule saison. Elle aura coûté 230 millions de dollars. En décembre 2023, lors du DealBook Summit organisé par le New York Times, le CEO Bob Iger reconnaît qu’il a fait fausse route. L’entreprise a perdu de vue son objectif principal : divertir le public. Il invite ses créateurs à revenir à l’Entertainment plutôt qu’à délivrer des messages politiques. Cette prise de conscience intervient alors que le géant du divertissement connaît une valeur boursière divisée par deux en deux ans. Pour se relancer, le patron démocrate souhaite s’extirper d’une guerre culturelle woke mortifère.
Jouer oui, mais pas avec nos pieds
Ubisoft, autrefois un titan du jeu vidéo, paie aujourd’hui le prix fort de sa politique woke. L'action de l'entreprise a chuté de 19% le 26 septembre 2023 à la suite de l'annonce du report de son titre phare, Assassin's Creed et des performances décevantes de Star Wars Outlaws. Sur les cinq dernières années, Ubisoft a perdu près de 80% de sa valeur boursière. La raison ? L’entreprise subit de grosses campagnes de boycott. Les gamers critiquent une « diversité forcée » au détriment de la qualité du gameplay. Ils accusent Ubisoft de « Virtue signaling », soit de céder à une pression politique woke plutôt que de se concentrer sur le développement de bons jeux.
Tant va la cruche à l’eau qu’elle se casse
Harley-Davidson, la marque emblématique fait volte-face également. En août 2024, la direction de l'entreprise, sous la houlette du PDG Jochen Zeitz, a annoncé l'abandon de sa politique de diversité, équité et inclusion (DEI). Attaquée de toutes parts par des lobbies anti-woke, elle a décidé de freiner toute initiative de marketing inclusif pour se concentrer sur son public traditionnel, les motards à la testostérone bien développée.
De manière générale, la plupart des entreprises américaines réévaluent leurs engagements woke. Essentiellement aussi parce que le robinet des subventions est coupé. En raison de leurs politiques ESG (Environnement, Social & Gouvernance), plusieurs États américains ont retiré des milliards de dollars d’investissements dans BlackRock et d’autres gestionnaires d’actifs. La Louisiane a retiré 794 millions de dollars de fonds à BlackRock. Le Texas et la Virginie-Occidentale ont exclu BlackRock des investissements de leurs fonds de pension d'État. D'autres États comme la Floride, le Kentucky et l'Oklahoma ont adopté des lois limitant la collaboration avec les gestionnaires de fonds priorisant l'ESG. Les républicains et les États conservateurs accusent, à juste titre, ces entreprises de négliger les rendements au profit de valeurs sociales et environnementales, un biais coûteux par rapport aux priorités économiques.
Le baromètre du portefeuille
Désormais, face à un contexte économique incertain et une pression sur les rendements, les investisseurs privilégient à nouveau (fort heureusement) la performance financière. Selon un rapport 2024 de PricewaterhouseCoopers (PwC), 60 % d’entre eux estiment que les entreprises devraient accorder moins d’importance aux causes sociétales et se concentrer davantage sur la rentabilité. En 2020, ce chiffre était de 42 %.
L’obsolescence du wokisme était-elle programmée ? Son déchaînement paroxystique sonne à tout le moins le glas de sa radicalité. Parce que devenir woke, c’est faire faillite (« go woke, go broke »), le recul des idées woke ne tient finalement qu’à un seul pouvoir, le plus fort : celui du portefeuille. Et quand le porte-monnaie se dégarnit, le vent tourne immanquablement.